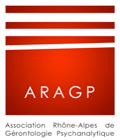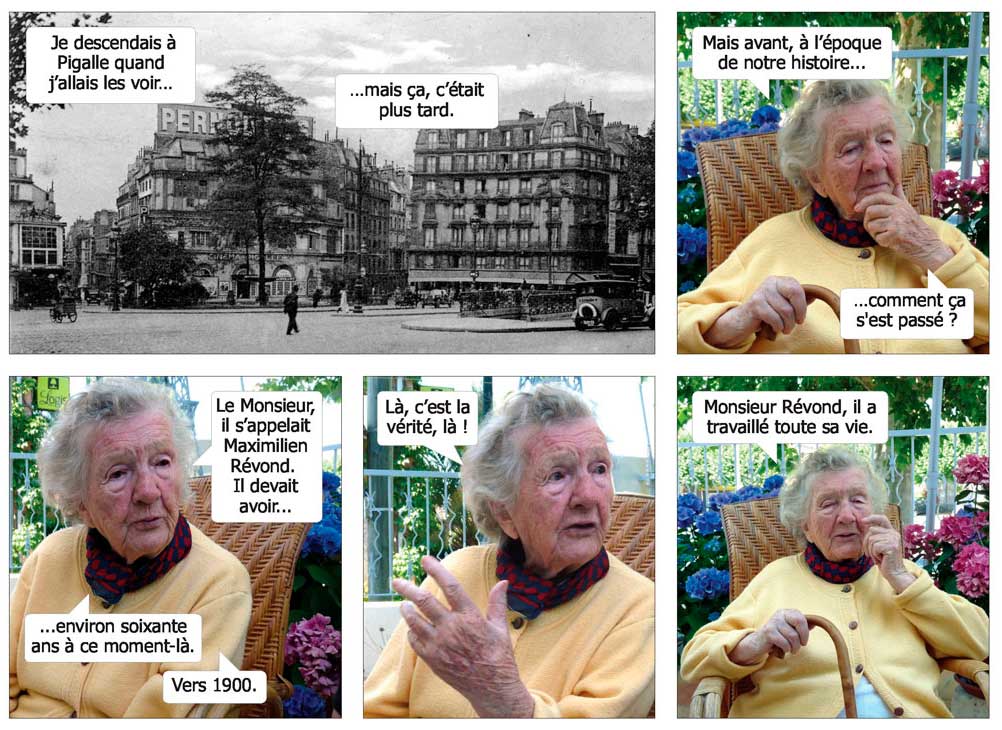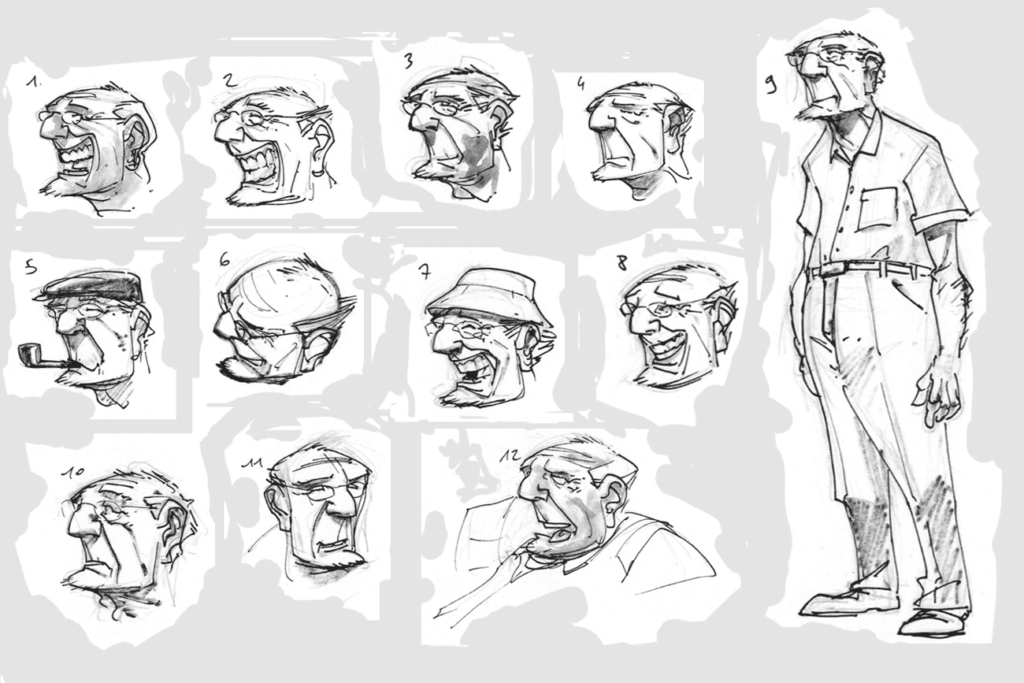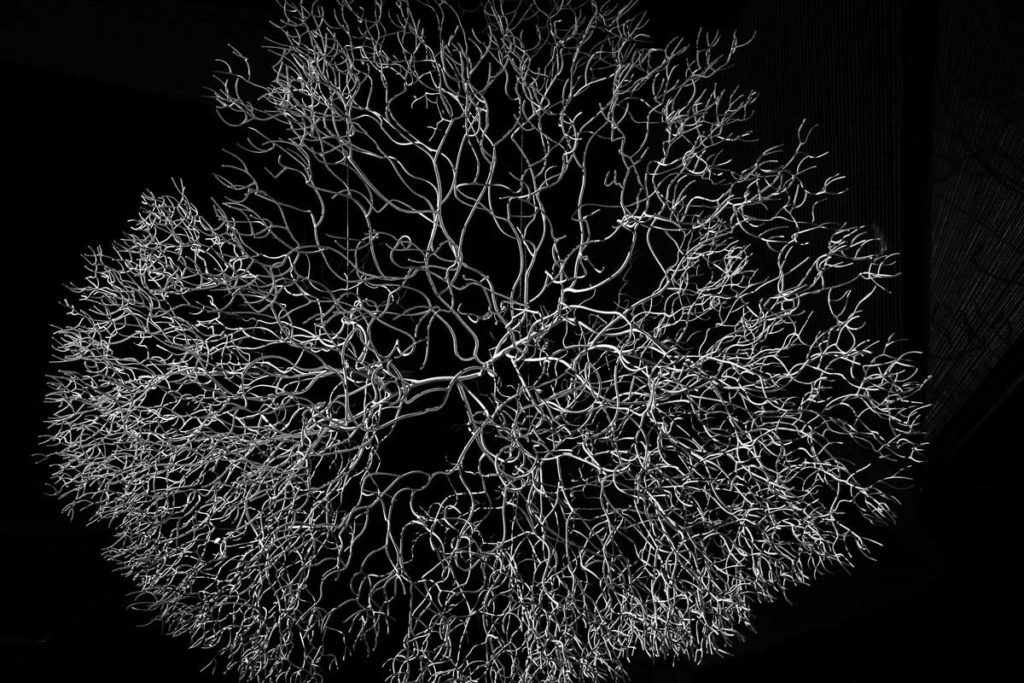journées
Sens dessus dessous. Vieillissement et sensorialité
36ème journée de l’ARAGP
19 janvier 2024
Les vieux, ça compte ? Economie psychique, argent et psychisme
35ème journée de l’ARAGP
21 janvier 2023
Figures de la passivité au grand âge. Accueils, écueils, risques et ouvertures
34ème journée de l’ARAGP
14 janvier 2022
Un virus chez les vieux. Sur le confinement, le dé-confinement et quelques-uns de leurs effets psychiques
33ème journée de l’ARAGP
9 janvier 2021
Mal de vivre. La mélancolie au crépuscule de la vie.
32ème journée de l’ARAGP
17 janvier 2020
Tissages d’histoires et travail d’historicisation
31ème journée de l’ARAGP
25 janvier 2019
Rire entre les rides. Humour et rire dans la vie psychique tardive
30ème journée de l’ARAGP
19 janvier 2018
Vieux secrets… Secrets de vieux
29ème journée de l’ARAGP
20 janvier 2017
Que sont nos pulsions devenues ?
28ème journée de l’ARAGP
16 janvier 2016
Vieux d’ici, soignants d’ailleurs. Vieux d’ailleurs, soignants d’ici. Vieillissement et interculturalité
27ème journée de l’ARAGP
24 janvier 2015